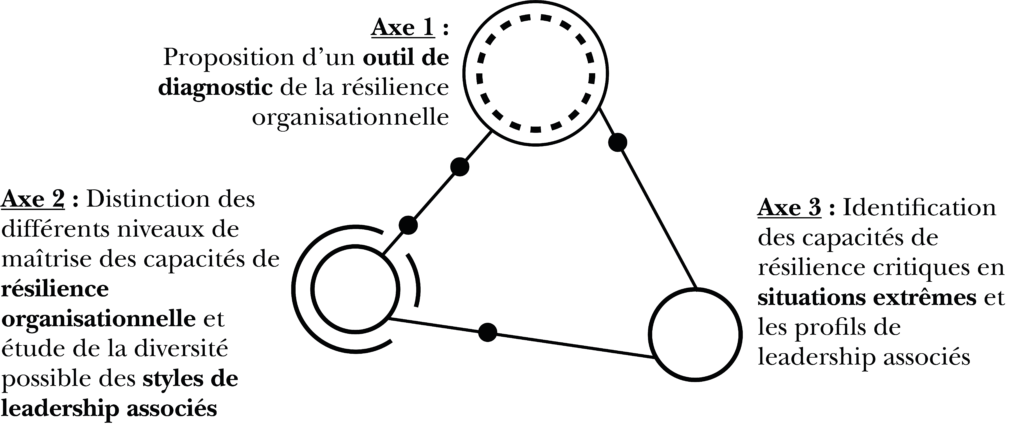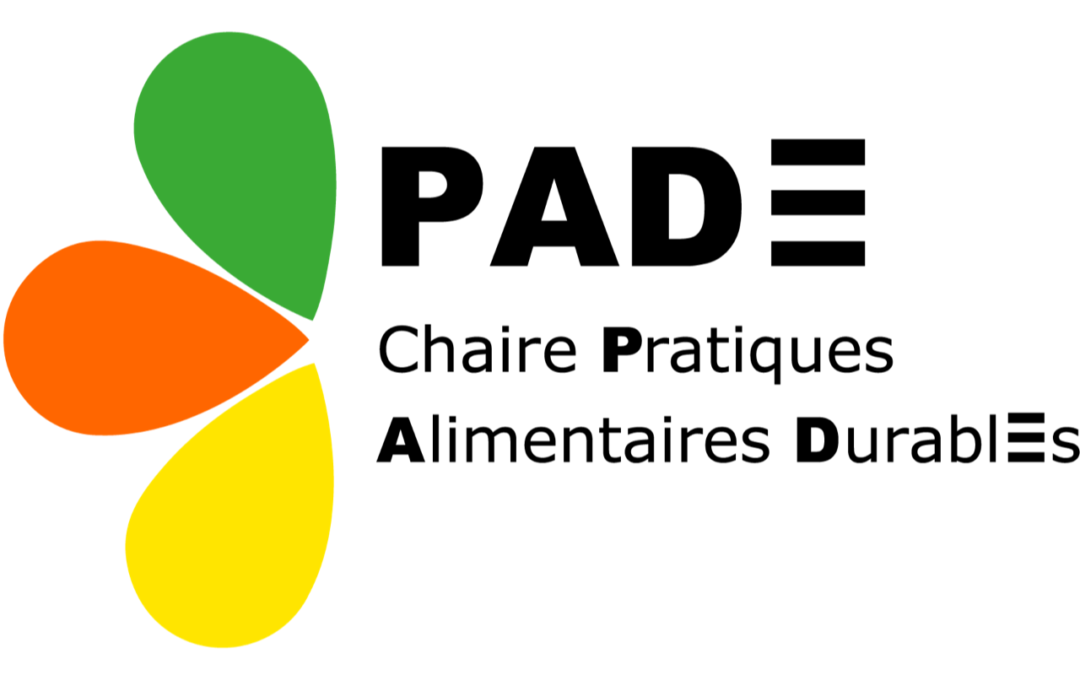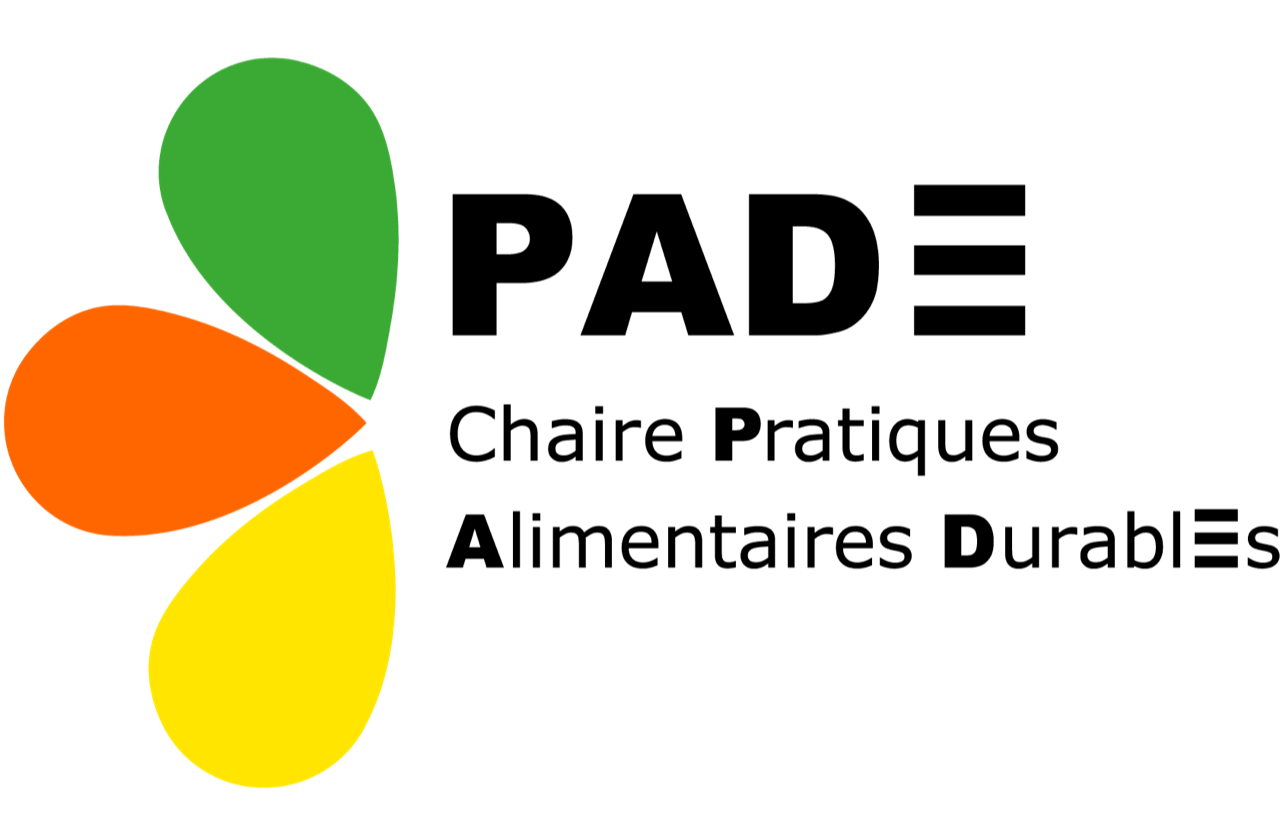RETERALIM

Responsable de projet
- Agnès LECOMPTE – Maître de conférences
Équipe
Laboratoire GÉOARCHITECTURE
- Florence GOURLAY – Maître de conférence
- Ronan LE DELEZIR – Maître de conférence
- Emma LE LAY – Ingénieure d’études
- Jean-Baptiste PASBECQ – Stagiaire Master 2
Laboratoire LEGO
- Camille CLEUZIOU – Ingénieure d’études
- Morgane INNOCENT – Ingénieure de recherche
- Mériam KARAA – Maître de conférence
- Manon LOBJOIS – Doctorante
- Jomana MAHFOD – Maître de conférence
- Hasna SABIR – Enseignante chercheuse
UCO
- Sylvie FOUTREL – Maître de conférence
2 Laboratoires impliqués : Laboratoire LEGO, Laboratoire Géoarchitecture
3 partenaires : Lorient agglomération Mady & Co, la Chambre d’Agriculture du Morbihan
BUDGET : 186 k€ (financé par ADEME)
DURÉE : 2 ans
RETERALIM
Reterritorialisation de l’alimentation par le développement des filières locales: le cas du Pays de Lorient
Objectifs
Le projet vise à accompagner les institutions publiques du Pays de Lorient dans leur effort de création de filières alimentaires locales. Il s’agira principalement d’identifier sous quelles conditions les producteurs pourraient privilégier des filières de distribution intraterritoriales, et de mettre en évidence les solutions et infrastructures logistiques nécessaires à la mise en place d’un tel objectif. Au-delà des éléments de diagnostic et d’identification de solution, le projet sera une occasion indirecte de mobiliser les producteurs auprès des solutions existantes, et d’aider à l’animation de filières locales existantes ou en construction.
Le projet est organisé en trois lots qui permettront in fine de répondre à trois grands objectifs:
- Comprendre les leviers et les freins au niveau des acteurs de la production et de la logistique pour une reterritorialisation de l’alimentation.
- Étudier les liens que ces démarches pourraient entretenir avec la réduction de l’agribasching.
- Apporter des éléments de connaissance concernant les méthodes de création de nouvelles filières territorialisées.
Méthodologie
La méthodologie du projet de recherche suit une méthodologie de recherche-action qui s’appuiera sur des données terrain auprès des producteurs/éleveurs d’une part et auprès des acteurs intervenant dans la filière logistique d’autre part.
Dans un premier lot, la méthodologie se base sur une série d’entretiens qualitatifs, pour étudier la filière lait du pays de l’orient, du fait d’une initiative prometteuse en cours sur le territoire.
Dans un second lot, des enquêtes qualitatives seront menées avec es producteurs et des acteurs de la logistique sur deux filières agricoles du Pays de Lorient pour élargir le sujet au-delà de la filière lait.
Enfin dans un dernier lot, des enquêtes quantitatives et une cartographie de ces deux filières viendront valider et quantifier les résultats.
Résultats
Le projet donnera lieu à trois livrables ayant vocation à accompagner la transformation du système alimentaire territorial du Pays de Lorient: profilage des producteurs du territoire et une cartographie des acteurs par filière, recommandations sur les outils permettant d’améliorer l’image des producteurs du territoire et de sensibiliser les habitants au soutien du système alimentaire local.